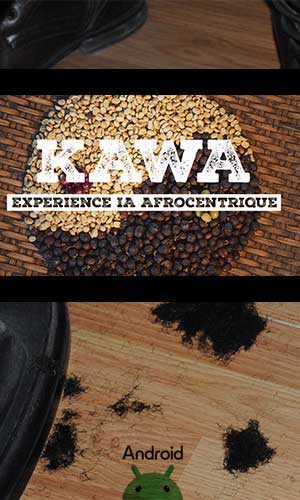Tout d’abord, j’ai hésité. Parce que d’aucuns, aux É.-U., avaient appelé au boycottage de ce film. « L’esclavage est une tragédie, pas un western spaghetti », avait lancé Spike Lee. Et j’étais d’accord avec lui. L’esclavage est une tragédie.
Seulement, voilà : Django, malgré ses apparences, n’est pas du tout un western spaghetti. Et c’est un film dont le propos évident est de montrer toute l’ampleur de la tragédie.

On a fortement critiqué l’utilisation abusive du mot « nigger ». Cependant, certains critiques trouvent l’emploi du mot justifié par le contexte historique du film. Le réalisateur afro-américain Spike Lee, qui s’est déjà plusieurs fois opposé à Tarantino pour la même raison, déclare qu’il est contre le film et qu’il ne le verra pas : « Je pense que ça serait manquer de respect à mes ancêtres.»
Tarentino a voulu dévoiler la violence de l’esclavage. Et parce qu’il a ressenti toute cette férocité, il a dû la canaliser dans un genre qui lui permettait d’en rajouter.
Pour ce natif du Tennessee, État esclavagiste du Sud des États-Unis, le western s’imposait. L’avantage de ce qui pourrait sembler une parodie de western spaghetti, c’est que la brutalité apparente et caricaturale des images pouvait en cacher une autre, qui ne s’exprime pas seulement par l’effusion du sang.
Cette barbarie est celle des plantations de coton du Mississippi qui n’ont pas grand-chose à envier, vues par Tarantino, aux camps d’extermination. Moi qui reviens de ces contrées, j’en frissonne.
L’action se situe vers 1858, trois ans avant le début de la guerre civile qui aboutira à l’abolition générale de l’esclavage aux É.-U.. Laissons donc de côté les apparences du film, où le sang coule beaucoup, c’est vrai. Mais ceux qui meurent de mort violente sont pour la plupart odieux et surtout ridicules. Ah si les salauds et les imbéciles pouvaient tous disparaître de cette façon!
Au-delà de la cruauté apparente du western qui n’est jamais complaisante et toujours respectueuse de ce qu’il y a de respectable dans la nature humaine, il y a la violence du sujet traité, beaucoup plus insupportable que cette hémoglobine copieusement et presque joyeusement dispersée.
Bien sûr, certaines choses auraient pu être montrées autrement. Il viendra un moment où l’esclave au cinéma ne se reconnaîtra plus seulement aux marques convenues du fouet sur le dos, mais aussi à sa maigreur extrême puisque le profit des esclavagistes était fondé sur les économies de nourriture. Encore un peu trop dodus, peut-être, les esclaves de Tarentino.
Mais pour le reste, il n’y a rien à redire.
Django, c’est Jean. Jean l’apôtre, celui que dans l’Évangile on surnomme le « fils du tonnerre ». Mais il n’a rien de miséricordieux pour les méchants, Django, qui va ponctuer cette histoire par l’apocalypse qui leur convient.
Django c’est aussi, et Tarantino prend bien soin de nous le rappeler très explicitement, le héros Siegfried dont le destin va être de délivrer sa princesse Brunehilde, gardée par un monstrueux dragon et une impénétrable muraille de feu.
Django c’est surtout d’Artagnan – même si le d’Artagnan du film est livré aux chiens – et l’on peut imaginer à quel point j’ai pu être ému, au moment le plus décisif de cette histoire, lorsque Tarantino rend hommage à Dumas, comme jamais personne avant lui n’avait pu ni osé le faire.
Django met en valeur, d’une manière très originale, toute la dignité d’un homme – peu importe sa couleur – dont la liberté, jusque dans l’esclavage, ne peut être brisée.
C’est un appel très clair à la révolte. Et j’ai bien peur, pour cette raison, que certains Français n’apprécient guère. Mais comme ces Français-là ne m’aiment pas et que je le leur rends bien, j’en suis ravi.
Il est bien difficile de réussir un film sur l’esclavage. Force est de reconnaître que Tarantino y est parvenu. Dès le générique, celles et ceux que la question touche d’une manière particulière auront bien du mal à réfréner quelques larmes. Ils ne pourront s’empêcher de se réjouir lorsque Django brise lui-même ses chaînes et punit les méchants.
La réussite suprême aura été de confier au magnifique acteur Samuel Jackson le rôle vraiment exécrable du traître, du nègre de case, du scélérat absolu, de l’infâme collaborateur. Aucun de ceux qui ont joué ce rôle, en France, sous les projecteurs, au cours des cinq dernières années, ne se reconnaîtra. Ceux qui perpétuent cette tradition sous couvert de changement se reconnaîtront encore moins. Et ce fut là ma jouissance : je les ai reconnus. Vous les reconnaîtrez aussi. Jackson les incarne tous. Et à la perfection.
En un mot, il faut courir voir ce film. D’abord parce que c’est un chef-d’œuvre, indépendamment du sujet et du genre. On pleure et l’on rit, sans seulement avoir le temps de se rendre compte à quel point la photographie est soignée. La musique, qui rend hommage au genre, est parfaite.
Et l’on sort de cet univers bouleversé, mais rasséréné, avec l‘envie d’y retourner.
Il faut aussi le voir parce que c’est le meilleur film jamais réalisé jusqu’à présent sur l’esclavage. Tarantino a placé la barre très haut.
D’autres films suivront. Et ceux qui les feront devront tous quelque chose à ce réalisateur bizarre : un tiers italien, un tiers irlandais, un tiers Cherokee. Mais en réalité, il faut bien le reconnaître, nègre au plus profond de lui-même. Il n’y a pas un soupçon de racisme chez cet humaniste et c’est tellement rare. Le mot « Nigger », souvent répété, ne pose aucun problème.
Il faut enfin aller voir Django pour que ce soit un succès en France et que d’autres films de la même veine puissent enfin y être produits, pour qu’il n’y ait plus jamais de Case Départ ni d’imposteurs pour en dire du bien.
En un mot, il y a un avant et un après Django. Au nom de tous mes combats, j’en suis personnellement très reconnaissant à Quentin Tarantino.
A lire aussi
A découvrir ... Actualités
Une exaltante quatrième édition du Gala Souper des Entrepreneurs (Gala SDE)
1er février 2025, première journée du fameux Mois de l’Histoire des Noirs, le Gala Souper des Entrepreneurs (Gala SDE), un …
Le Dernier Repas de Maryse Legagneur
Sous une musique de Jenny Saldago (Muzion), le film Le Dernier Repas de de Maryse Legagneur, nous trempe dans une …
Amazon Web Services choisit le quartier Saint-Michel et le Centre Lasallien
La fierté et la joie étaient palpable en ce lundi matin ensoleillé du 30 septembre 2024 quand une centaine de …