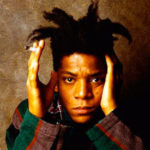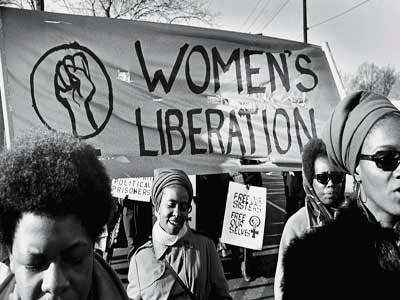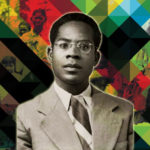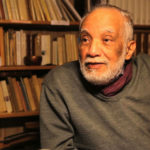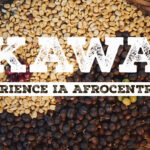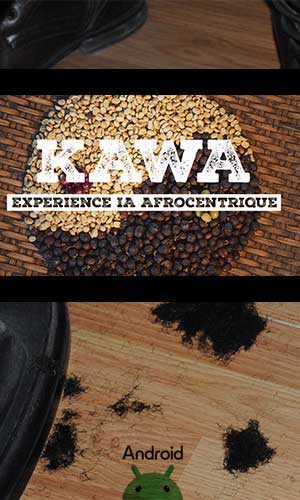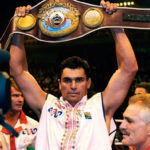Le 12 juin 2019, par un voeu défendu par l’adjointe à la mémoire Catherine Vieu-Charier, la ville de Paris envisageait de donner à une voie parisienne le nom de Solitude, et l’on ne peut que s’en réjouir, car Solitude est une héroïne bien ancrée dans la mémoire collective des Guadeloupéens.

Née vers 1772, Solitude est la fille d’une esclave africaine, violée par un marin sur le bateau qui la déportait aux Antilles.
Lorsque, par la loi du 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage dans les colonies, Solitude se rallie à l’appel de Louis Delgrès et combat à ses côtés pour la liberté. Survivante de la bataille du 28 mai 1802, elle est condamnée à mort et emprisonnée, entre mai et décembre 1802, jusqu’à son accouchement. Elle est exécutée par pendaison le 29 novembre 1802, le lendemain de son accouchement.
Cependant, l’idée de reprendre l’épithète de « mulâtresse » accolée au nom de Solitude dès 1858 par le magistrat Auguste Lacour, conseiller à la cour de Basse-Terre, héritier d’une grande famille esclavagiste, et par ailleurs auteur d’une histoire de la Guadeloupe, intéressante, mais bien souvent discutable, a de quoi surprendre.
Tous les personnages guadeloupéens présentés par Lacour comme secondaires dans son histoire sont en effet affublés d’une épithète raciste évoquant leur couleur: le nègre Sans-Peur, la mulâtresse Marthe-Rose… Bien sûr, Solitude n’échappe pas à la règle.
Lacour partageait les préjugés coloniaux de son époque — le Second Empire — et surtout de sa caste, celle des grands planteurs.
Force est de reconnaître, pourtant, que c’est grâce à lui que Solitude est connue.
Et voici ce qu’il en dit (Histoire de la Guadeloupe, Basse-Terre, 1858, tome 3, p 311):
« Les négresses et les mulâtresses surtout se montraient acharnées contre les femmes blanches. La mulâtresse Solitude, venue de la Pointe-à-Pitre à la Basse-Terre, était alors dans le camp de Palerme. Elle laissait éclater, dans toutes les occasions, sa haine et sa fureur. Elle avait des lapins. L’un d’eux s’étant échappé, elle s’arme d’une broche; court, le perce, le lève, et le présentant aux prisonnières : “Tiens, dit-elle, en mêlant à ses paroles les épithètes les plus injurieuses, voilà comme je vais vous traiter quand il en sera temps!” Et cette malheureuse allait devenir mère! Solitude n’abandonna pas les rebelles et resta près d’eux, comme leur mauvais génie, pour les exciter aux plus grands forfaits. Arrêtée enfin au milieu d’une bande d’insurgés, elle fut condamnée à mort; mais on dut surseoir à l’exécution et la sentence. Elle fut suppliciée le 29 novembre [1802], après sa délivrance. »
Solitude avait évidemment laissé une trace dans la mémoire collective. Mais c’est à partir de ce paragraphe de Lacour que les Guadeloupéens du XIXe et du XXe siècle ont fait de Solitude — par réaction sans doute à l’image féroce qu’en donne le magistrat — une héroïne de la résistance à l’esclavage qui a inspiré plusieurs romans.
Le plus célèbre est celui d’André Schwarz-Bart, publié en 1972, qui a repris pour titre la formule de Lacour, La mulâtresse Solitude. Outre qu’il ne faut pas prendre ce titre au premier degré, un nom de rue n’est pas la même chose qu’un titre de livre. On imagine difficilement à Paris une rue du Nègre qui vous emmerde, en hommage à Aimé Césaire.
D’ailleurs, la traduction américaine de l’ouvrage de Schwarz-Bart est A woman called Solitude (une femme nommée Solitude). « Mulatto », l’équivalent de « mulâtresse » est une épithète si dégradante en anglais qu’elle n’était pas envisageable un seul instant.
Il en va de même en français. Plus encore que « mulâtre », « mulâtresse », comme l’a bien reconnu le lexicologue Jean Rey dans l’édition de 2011 du Robert, est un adjectif particulièrement péjoratif et dépréciateur.
Bien sûr, il y aura toujours des gens pour dire le contraire et pour vouloir donner des leçons d’histoire aux Guadeloupéens. Des gens qui savent mieux qu’eux ce qui est bon ou mauvais pour eux. Ce sont les mêmes pour qui c’était une bonne idée de rebaptiser Bal nègre, le Bal Blomet.
Pourtant, « mulâtresse » ou « mule », c’étaient des termes méprisants de colons racistes pour désigner les filles issues généralement d’un viol, avec l’idée sous-jacente d’une prétendue lubricité appelant de nouveau au viol.
On sait par ailleurs que le mulet est le produit stérile de la relation âne-cheval. Le terme de mulâtre – mulatto – était une façon de plus d’animaliser pour inférioriser.
Le plus triste, c’est que beaucoup reprennent l’expression en ignorant complètement ce qu’elle véhicule.
S’il est évident que Solitude ne mérite pas d’être rabaissée par une épithète outrageante — surtout sous le prétexte d’être honorée — les Guadeloupéens, déjà meurtris par les propos de Christine Angot (que la classe politique est loin d’avoir unanimement condamnés) n’avaient, en ce qui les concerne, pas besoin d’une humiliation de plus.
À moins qu’on en arrive, comme dans le livre de Lacour, à indiquer sur (presque) toutes les plaques des noms de rue de Paris qu’il s’agit bien de « blancs ».
À moins que demain, dans les écoles parisiennes, certains professeurs, encouragés par l’existence d’une allée de la mulâtresse Solitude, puissent impunément apostropher certains de leurs élèves en accolant eux aussi l’épithète de « mulâtre » ou de « mulâtresse » aux patronymes.
Pour en savoir plus sur Solitude
Pour en savoir plus sur les termes « mulâtre » et « mulâtresse »
A lire aussi
A découvrir ... Actualités
Une exaltante quatrième édition du Gala Souper des Entrepreneurs (Gala SDE)
1er février 2025, première journée du fameux Mois de l’Histoire des Noirs, le Gala Souper des Entrepreneurs (Gala SDE), un …
Le Dernier Repas de Maryse Legagneur
Sous une musique de Jenny Saldago (Muzion), le film Le Dernier Repas de de Maryse Legagneur, nous trempe dans une …
Amazon Web Services choisit le quartier Saint-Michel et le Centre Lasallien
La fierté et la joie étaient palpable en ce lundi matin ensoleillé du 30 septembre 2024 quand une centaine de …