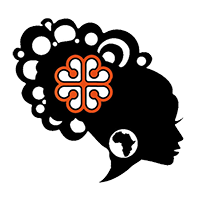Par catégorie...
Editors
-
 Adil Goumma
Adil Goumma -
Alain Kalonji
-
Alain SAMBOU
-
 Carole DA SILVA
Carole DA SILVA -
Christopher Loïs Merisier
-
Claire Machia Fundu
-
Claude Ribbe
-
Communiqués
-
Cyrille Ekwalla
-
 Dorothy Alexandre
Dorothy Alexandre -
 Dr. S. N. Jafralie
Dr. S. N. Jafralie -
Edem Ganyra
-
Fahimy Saoud
-
Isabelle Souffrant CPA
-
Jean-Paul Pougala
-
Kamal Az.
-
Kanange
-
Lenia
-
 Ligue des Noirs du Québec
Ligue des Noirs du Québec -
Lionel Rémion
-
Marie Ange Barbancourt
-
 Maxime St-Juste
Maxime St-Juste -
Maximin Emagna
-
 Mayamba Luboya
Mayamba Luboya -
Mohamed Ibn Khaldoun
-
Nadia Michelot
-
 Ndiaga Loum
Ndiaga Loum -
 Nicoletta Da Silva
Nicoletta Da Silva -
 Odile Rampy
Odile Rampy -
 Pablo Michelot
Pablo Michelot -
 Pallina Michelot
Pallina Michelot -
Pascale Gabriel
-
Paul Emile Okoka
-
Pierre Loua
-
Rachel Décoste
-
 Samba Axel
Samba Axel -
 Serge H. Moïse
Serge H. Moïse -
Thierno Seydou Diop
-
Vernet Larose
-
 Walter Innocent
Walter Innocent -
 Zaz
Zaz -
 Zena Liberato
Zena Liberato
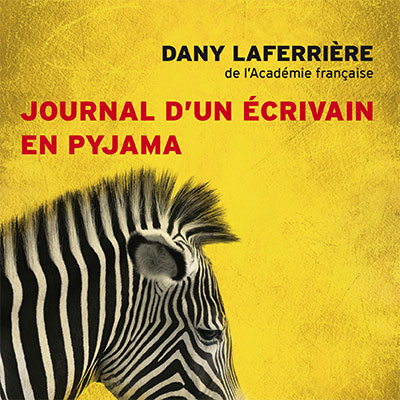
I. L’élan
À l’époque, j’habitais un meublé surchauffé à Montréal, et je tentais d’écrire un roman afin de sortir du cycle infernal des petits boulots dans les manufactures en lointaine banlieue. Mes voisins étaient de jeunes clochards, imbibés de bière, qui n’avaient pas assez d’argent pour la cocaïne (le crack n’avait pas encore envahi les quartiers pauvres de la ville). Je retrouvais, le samedi soir, les copains d’usine, dans une discothèque que fréquentaient des femmes qui auraient pu être nos mères. C’est la promesse de l’Amérique à ceux qui partent travailler avant la lumière du jour et reviennent, le soir, manger un spaghetti tout en regardant un mauvais film à la télé. Je voulais la même promesse que l’Amérique fait à ses gosses surprotégés des quartiers huppés. À l’usine, je ne valais pas tripette, ne sachant rien faire de mes mains. Sauf écrire. On oublie qu’écrire est un travail manuel. Peut-on se mettre tout d’un coup à écrire un livre sans fréquenter aucun groupe littéraire, ni même un club de lecture ? Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Mais écrire est différent de lire. L’écrivain et le lecteur sont aux deux extrémités de la chaîne.
II. La machine
Je suis allé au coin de la rue acheter une vieille machine à écrire que je voyais depuis un moment dans la vitrine d’un brocanteur. Je ne voulais pas écrire ce roman à la main. Je vivais dans cette partie du monde qui a fait sa fortune à l’aide de la machine. Je voulais être un écrivain contemporain, et non un de ces paysans du tiers-monde encore à l’âge de la roue. C’était une vieille Remington 22 en bon état. Elle s’est retrouvée sur la table de cuisine, à côté d’une corbeille de fruits. Je tiens ce goût des fruits de ma nature caribéenne. J’adore l’odeur suffocante des bananes trop mûres et des mangues jaunes qui m’agresse dès que j’ouvre la porte. Quelques jours plus tard, je me suis assis devant la machine pour écrire ma première phrase. J’ai attendu la suite tout l’après-midi. Je ne savais pas encore qu’il n’y avait rien de plus épuisant qu’une première phrase. Si elle passe, le reste du livre suivra. J’ai passé l’été à écrire avec un seul doigt tout en me nourrissant de fruits et de légumes. J’étais devenu un véritable athlète de l’écriture. Après un mois, j’ai compris que j’étais davantage un sprinter qu’un marathonien. J’étais plus à l’aise dans la phrase brève, les dialogues vifs et les commentaires ironiques que dans les longs développements et les interminables descriptions de paysages.
III. La douleur
J’avais décidé de ne pas trop souffrir durant l’écriture de ce roman. Comme ouvrier, j’estimais qu’écrire ne pouvait être qu’une récréation. On évoquait autour de moi la souffrance de l’écrivain, mais je ne me sentais jamais concerné. À la radio, durant une émission sur la littérature, un célèbre écrivain affirmait qu’on ne pouvait pas écrire si on n’avait pas souffert. Un autre ajoutait que l’écriture elle-même exigeait sa part de douleur. Ils ne parlaient, ce jour-là, que de souffrance. J’avais l’impression qu’ils connaissaient beaucoup plus le mot que la réalité. Sur ce plan, j’avais acquis mes titres de noblesse. Je venais de quitter une dicta- ture délirante pour devenir ouvrier dans une Amérique du Nord où le Noir était encore un citoyen de second ordre. Plus haut, c’était respirable, mais dans les bas-fonds de la classe ouvrière, les matins sont toujours gris et les ciels bas. À partir de cette vie quotidienne difficile, je voulais créer un univers aussi pétillant qu’une coupe de champagne. Je lisais Francis Scott Fitzgerald totalement fasciné par la grâce qui émanait de sa personne, et cela même dans des situations intolérables. Il me donnait l’impression d’avoir décidé, un jour, qu’il était un personnage de roman. Et c’est ce que j’entendais devenir.
IV. La ville endormie
Je lisais dans mon bain, et j’écrivais sur la petite table de cuisine. Je me sentais comme un dieu dans ce cadre pour- tant étroit où l’on n’entendait que la musique des mouches attirées par l’odeur insistante des fruits durant cette canicule. La chaleur était si forte que l’air sentait le soufre. Je filais de temps à autre sous la douche, mais à peine sorti de la salle de bains, j’étais de nouveau en sueur. Je tournais en rond dans la chambre, comme hypnotisé par la machine à écrire qui semblait me faire toutes les promesses du monde. Je savais qu’elle gardait dans son ventre toutes les phrases de mon roman. Je devais les extirper de là une à une. Ce ne fut pas toujours facile, mais j’avais tout mon temps, d’ailleurs je n’avais que cela. Je passais mes journées avec le plus beau jouet du monde. Je changeais un mot dans une phrase terne qui se mettait immédiatement à lancer des confettis. Quand j’avais écrit une page dont le rythme et la musique me plaisaient, je sortais prendre l’air, traversant la ville en somnambule. Après une bonne heure de marche, je rentrais, parfois sous la pluie, pour me remettre à ma table de travail. Et ça repartait jusqu’au milieu de la nuit. Il m’arrivait de me réveiller pour noter une idée, ou un bout de dialogue. Je restais alors un long moment dans le noir, tout entier à ma rêverie. Puis je me mettais à écrire, en effleurant les touches du clavier de façon à faire le moins de bruit possible. Après un moment, j’étais ailleurs, et je tapais comme un dératé jusqu’à ce qu’un voisin me hurle de cesser ce vacarme. Ce plaisir profond d’écrire dans une ville endormie. Je n’avais que ça en tête : écrire. C’était pour moi une fête perpétuelle.
V. La vie matérielle
Je ne sais pas pourquoi j’étais sûr que ce livre allait me sortir de ce trou. Pour écrire, il m’a fallu arrêter de travailler. Mes maigres économies baissaient à vue d’œil. Je devais faire vite et court. Je ne disposais pas des mêmes ressources financières que ces jeunes écrivains américains qui pouvaient laisser courir un premier roman jusqu’à 600 pages. Seul dans une ville inconnue, j’ai donc réduit au minimum mes dépenses et entrepris de séduire la fille du propriétaire de l’immeuble où je créchais. Le propriétaire, un Italien, ne m’avait pas à la bonne. Je m’arrangeais pour croiser sa fille plusieurs fois par jour dans l’escalier. Et nous nous retrouvâmes un soir dans ma chambre.
Depuis, je n’ai plus eu à payer de loyer. Cette angoisse apaisée, il me fallait régler la question de la nourriture. J’ai remarqué que cette caissière d’un certain âge me couvait des yeux chaque fois que j’allais acheter mes fruits et légumes chez Pellat’s. Elle finit par me faire savoir que ses vraies origines étaient africaines, et cela, malgré son apparence. En effet, elle était blonde comme les blés. Elle avait découvert un livre sur l’Afrique quand elle était petite, et depuis elle rêvait d’aller vivre là-bas. Il y a dans ce premier roman une trace d’elle quand je dis qu’en dormant avec un Noir, la Blanche risque de se réveiller au Sénégal. Il n’y avait entre nous que son désir de me protéger. Elle me faisait payer le dixième du prix de mes achats, tandis que la fille du propriétaire, qui tenait la comptabilité de son père, effaçait mes dettes. Doudou Boicel, qui dirigeait cette boîte de jazz (Soleil Levant), m’avait prévenu, dès mon arrivée : « Mets-toi du côté des femmes, elles ont du cœur. » Ainsi, j’ai pu écrire tranquillement mon premier roman.
VI. Une image
Il y a des images qui tiennent le lecteur par la nuque pour lui enfoncer la tête dans le livre, lui faisant ainsi croire qu’il ne lit pas un livre mais un écrivain. Quand on pense à Proust, on voit un homme qui passe ses journées au lit emmitouflé dans une pelisse. Hemingway avec un fusil de chasse ou fumant un gros cigare cubain sur son bateau de pêche. Le vieux Miller jouant au ping-pong avec des stripteaseuses. Gertrude Stein (mâchoire agressive et jambes bien écartées) regardant son interlocuteur droit dans les yeux pour lui dire qu’elle a détesté son roman. Mishima se faisant trancher la tête avec un sabre par son amoureux.
Truman Capote papotant dans la chambre à coucher de ces riches et élégantes Américaines sans éveiller le soupçon de leur mari. La lourde moustache de Günther Grass qui lui fait cette tête d’abruti. James Baldwin hilare dans les bras de Marlon Brando. Le regard si las de Virginia Woolf. Borges assis seul dans ce hall d’hôtel, avec sa canne d’aveugle entre les jambes. Les seins de Colette. L’Indochine de Duras. Lorca fusillé par Franco, et Jacques Stephen Alexis par Duvalier. Salinger, invisible. Homère, aveugle. Ovide, exilé. Faulkner en gentleman-farmer. Emily Dickinson refusant de quitter sa maison. Kafka, l’angoissé. Céline, le maudit. Tolstoï dans sa vareuse de moujik. Les multiples masques de Pessoa. Dante en enfer. Milton au paradis. Blake dévoré par un tigre. L’écrivain inconnu, comme on dit le soldat inconnu, en pyjama. Tous ces monstres ont un tag fluo- rescent qui leur permet d’être repérés dans cette jungle de papier.
VII. La promesse
Mon premier livre est paru en novembre 1985, et mon sort a changé. Je ne suis pas devenu riche, loin de là, mais depuis, je mène la vie dont j’ai toujours rêvé. J’ai bien fait de miser toute ma fortune et mon énergie sur cette carte. J’ai cru dans ces fables qui ont nourri mon enfance, surtout celles où un pauvre hère, d’un coup de baguette magique, devient un prince. Il suffit d’avoir une bonne fée, ce que fut l’écriture dans mon cas. Je suis encore étonné, moi qui voyage tant de n’avoir jamais payé un seul billet d’avion, ni une chambre d’hôtel, ni même un repas au restaurant. J’ai fait disparaître l’argent de mon champ visuel. Je traverse le monde, en sifflotant, laissant derrière moi une île à la dérive. Sans jamais l’oublier, j’ai su dès le départ qu’il fallait m’en distancer pour qu’elle ne m’entraîne pas dans sa spirale. Pour aider quelqu’un à sortir d’un trou, il ne faut pas s’y trouver avec lui. Me voilà, avec pour toute fortune au fond de ma poche les vingt-six lettres de l’alphabet. De phrases en paragraphes, de paragraphes en chapitres, pour former cette montagne sous laquelle s’agitent des sensations, des impressions, des émotions. J’ai lancé tout ça au visage du lecteur inconnu qui, au lieu de s’en indi- gner, l’a reçu avec amabilité. J’en ai écrit plein d’autres, mais rien n’est comparable au bonheur de voir son premier livre, sous une couverture jaune, à la vitrine d’une librai- rie – entre Moravia et Hemingway. Je ne connais pas de plus vif plaisir que d’entendre, sur mon passage, une jeune fille glisser à l’oreille de sa copine : « C’est lui, l’écrivain dont je te parlais. » En effet, c’est moi. Et je rêve d’entendre cette phrase, un jour, en japonais, puisqu’on écrit pour traverser clandestinement les frontières, à défaut de les effacer.
BIO
Né en Haïti, Dany Laferrière passe son enfance à Petit-Goâve. Il a débuté une carrière de journaliste à l’hebdomadaire Le Petit Samedi soir. Il part pour le Québec en 1976, fuyant la dictature des Duvalier suite à l’assassinat de son ami Gasner Raymond. Il travaille à Montréal comme ouvrier, puis se lance dans l’écriture avec un premier roman Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer (VLB, 1985). Le 12 décembre 2013, Dany Laferrière est élu à l’Académie française, son élection constitue un événement majeur dans les annales littéraires.
Contexte
« Le pyjama est un étrange habit de travail », nous dit Dany Laferrière, qui, après trente années d’écriture, décide de parler à ses lecteurs. Suite de fragments et de scènes où fiction, réflexion, récit, méditations s’alternent. Journal d’un écrivain en pyjama met sous nos yeux l’itinéraire de cet écrivain pour qui la vie est une aventure exaltante, qui se conjugue entre lire et écrire.
Dans L’art presque perdu de ne rien faire, la réflexion était sur la rêverie et la philosophie, et le rapport que nous entretenons avec la vitesse, Laferrière commandait de ralentir pour contrer cette espèce d’urgence. Cette réflexion se poursuit autrement dans Journal d’un écrivain en pyjama. L’auteur intervient ni en savant ni en érudit, mais plutôt en écrivain-lecteur, dandy, esthète passionné : Que lisons-nous ? Qu’écrivons- nous ? Et quelles sont les incidences des livres dans notre vie quotidienne?
-

Articles récents
- Madagascar se réveille : la jeunesse noire défie...17 octobre 2025
- Mots-Croisés - Donald Oliver18 septembre 2025
- Décès du sénateur Donald Oliver: Un demi-siècle...18 septembre 2025
- Milotche Media lance KaWa : Première application d'IA...10 mars 2025
- Madagascar se réveille : la jeunesse noire défie...
Produits
-
 Don
Don suggéré : $20.00
Don
Don suggéré : $20.00
-
 Bracelet "Je suis Lumumba"
$5.00
Bracelet "Je suis Lumumba"
$5.00
-
 Bracelet "Je suis Sankara"
$5.00
Bracelet "Je suis Sankara"
$5.00
-
 Bracelet "Je suis Louverture"
$5.00
Bracelet "Je suis Louverture"
$5.00
-
 Bracelet "Je suis Nigeria"
$5.00
Bracelet "Je suis Nigeria"
$5.00
-
-
L'Encre Noir